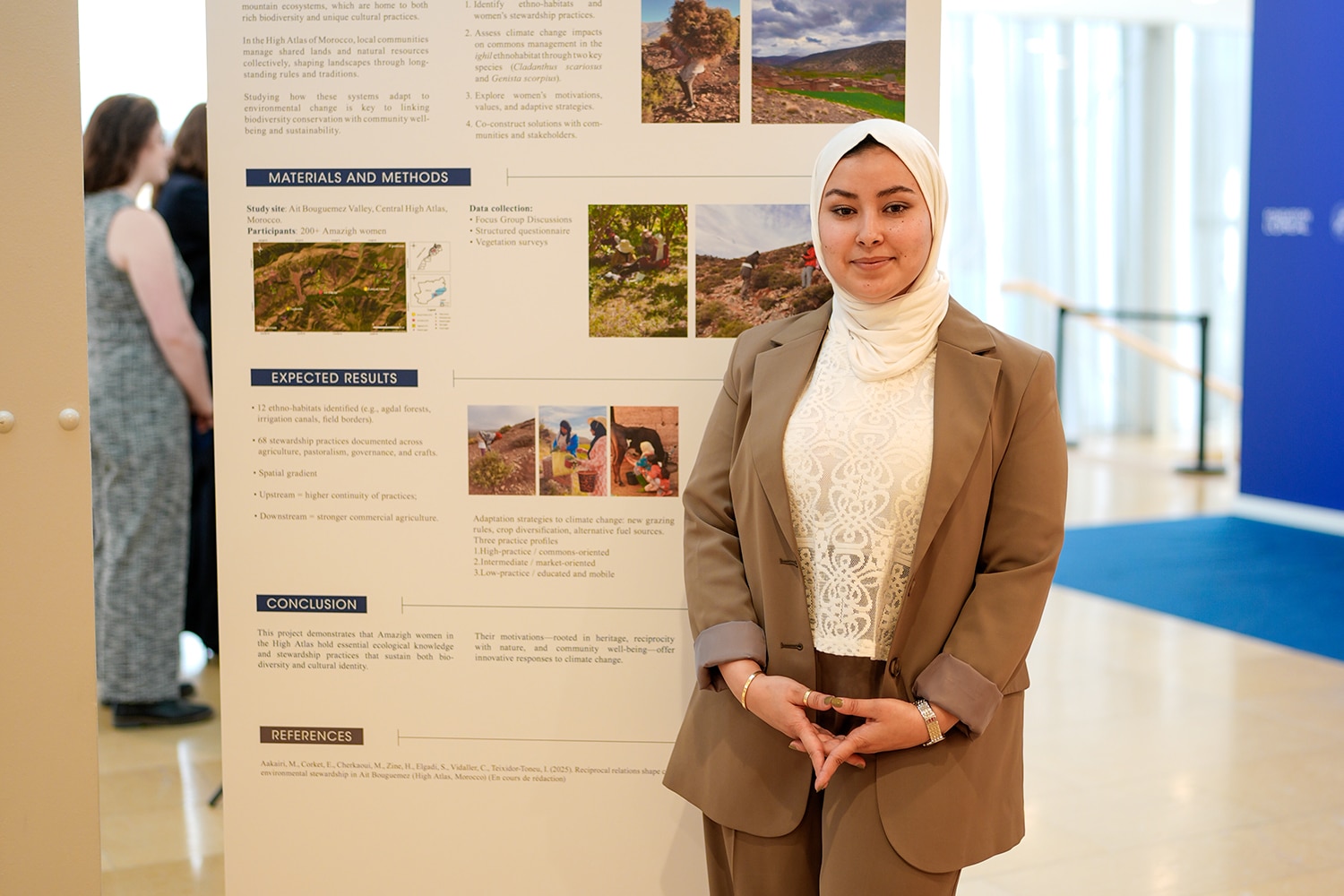Lauréate le 8 octobre dernier du Prix Jeunes Talents L’Oréal-UNESCO 2025, la chercheuse marseillaise Meryem Aakairi veut replacer les savoirs écologiques des femmes amazighes au cœur de la recherche.
« La science ne doit pas seulement observer, mais aussi écouter », affirme Meryem Aakairi. Née à Agadir, la jeune chercheuse partage aujourd’hui sa vie entre le Maroc et Marseille, où elle est doctorante au sein de l’Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Écologie (IMBE).
Elle consacre sa thèse à la valorisation des savoirs ancestraux pour une science inclusive et vient de décrocher le Prix Jeunes Talents L’Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science. Pourtant, rien ne la prédestinait à la recherche. Après un master en biologie et environnement, elle devait effectuer un simple stage de deux mois en agroécologie. « Ce stage s’est transformé en deux années de terrain, au cours desquelles j’ai appris à écouter la nature et à comprendre ce que signifie respecter le vivant », raconte-t-elle.
La pandémie de Covid lui offre ensuite un temps d’arrêt propice à la réflexion. Elle en profite pour réorienter son parcours et approfondir son travail dans le Haut Atlas, aux côtés des femmes rurales dont elle découvre le rôle essentiel dans la préservation de la nature.

Les femmes amazighes, gardiennes invisibles de la montagne
Ces femmes amazighes vivent dans les zones montagneuses du Maroc. Depuis des générations, elles entretiennent une relation étroite avec leur environnement, basée sur l’observation, la transmission et la coopération. « Elles sont en interaction quotidienne avec la nature, mais absentes des espaces de décision », souligne la chercheuse.
Sur le terrain, Meryem Aakairi privilégie la co-construction. « Avant de poser des questions, j’écoute, je partage des moments de vie. Nous parlons la même langue, cela crée une proximité très forte », explique-t-elle. Grâce à cette confiance, elle documente des pratiques locales d’adaptation au climat.
Dans certaines vallées, les femmes ferment chaque année une partie de la montagne pour laisser la végétation se régénérer. Face à la sécheresse, elles prolongent désormais ces périodes de repos ou ajustent les zones ouvertes à la cueillette. Pour la chercheuse, ces systèmes communautaires illustrent l’importance de solutions locales, souples et dynamiques, face au changement climatique.

Réhabiliter les savoirs oubliés
Faire reconnaître ces pratiques dans la recherche n’a pas été simple. « Au départ, il a fallu convaincre que ces savoirs avaient leur place dans la science », confie-t-elle.
En tant que femme, elle a aussi dû prouver sa légitimité dans un milieu encore marqué par des logiques masculines. « On attend de nous de la patience, rarement du leadership. Pourtant, notre présence transforme la manière de faire de la science », affirme-t-elle.
Pour Meryem Aakairi, écouter les communautés qui vivent directement les effets du dérèglement climatique, enrichit la recherche. « Ces femmes dépendent des plantes et des animaux pour leur survie. Intégrer leurs savoirs, c’est encourager la gestion collective des ressources et reconnaître la diversité culturelle comme une richesse pour la planète. » Son credo : penser globalement, agir localement.
Une reconnaissance partagée
Sa démarche a suscité une véritable fierté sur le terrain. « Les femmes amazighes se sentent écoutées, reconnues. Elles sont heureuses que leurs connaissances soient enfin étudiées et valorisées », se réjouit-elle. Pour elles, cette recherche est aussi une manière de transmettre à la jeune génération un héritage menacé par la modernisation et l’exode rural.
À travers son parcours, Meryem Aakairi incarne une nouvelle génération de chercheuses qui veulent reconnecter la science avec le vivant. Une science ancrée dans la réalité des territoires, ouverte aux voix longtemps ignorées, et surtout, profondément humaine.