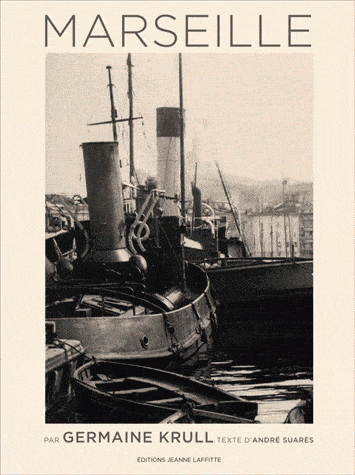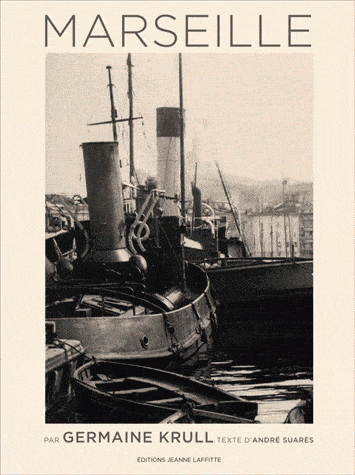Loin de Paris et des clichés, découvrez 3 livres sur Marseille. Un peu de littérature pour sortir des clichés sur Marseille, une chronique de Marius Escartefigue pour Made in Marseille…
Au début de juin 2014, plusieurs articles de presse indiquaient que, d’après un décompte de l’Institut national de l’audiovisuel (INA), Marseille était, en dehors de Paris, la ville la plus médiatisée de France avec 2103 passages en quatre ans dans les journaux télévisés des grandes chaînes nationales[1]. En 2013, la ville faisait l’objet de 518 reportages sur les mêmes chaînes. Effet direct d’un millésime où Marseille était « capitale européenne de la culture » ? Pas du tout, car, d’après le même décompte de l’INA, seuls 63 sujets concernaient cet événement, soit seulement 12,6% du total. En toute bonne logique médiatique, l’essentiel concernait des règlements de compte, des braquages et des faits divers…
Le phénomène n’est pas nouveau et illustre la mauvaise réputation dont la ville a toujours pâti. Ainsi, l’historien britannique Richard Cobb a consacré une étude à la position « ambivalente et contrastée » occupée par Marseille dans la littérature française[2]. Mais alors que, durant des décennies, la galéjade « marseillaise » destinée à faire rire le Parisien avait tenu le haut du pavé, c’est désormais le fait-divers, de préférence nauséeux, qui provoque l’unanimité dans les salles de rédaction nationales qui font l’opinion.
En effet, Marseille suscite les vocations des commentateurs professionnels ou amateurs. Les livres évoquant nombre d’aspects de la ville se sont multipliés ces dernières années, et bien des personnes, dès qu’on en parle, se sentent obligées de gloser, à tort et à travers, pour bâtir des généralités hâtives ou émettre des jugements aussi sentencieux que dénués de fondement. Plus sérieusement, si l’on ajoute que le grand Walter Benjamin, qui aimait décrire les villes qui l’attiraient, reconnaissait lui-même que quelque chose lui échappait quand il voulait écrire sur Marseille, on comprendra aisément qu’il n’est pas facile d’évoquer la ville sans tomber dans le cliché et que, de toute manière, quelque chose échappera presque toujours au regard, même le mieux exercé.
Pourtant, au hasard des publications, quelques livres permettent d’évoquer tel ou tel aspect de Marseille, au passé comme au présent, dont on aurait tort de se priver. On a déjà vu que les grandes chaînes de télévision avait réservé la portion congrue à l’année « capitale de la culture » en 2013. Sans revenir sur les fondements de tels événements dont la critique a été faite, et bien faite, soulignant qu’ils marquent le mariage de l’art et de l’entreprise[3], c’est celui-ci qui sert de prétexte à un roman épistolaire à deux voix, If Marseille…
Deux auteurs, très différents, étrangers à la ville, sont invités en résidence à Marseille en 2012 pour préparer des ouvrages pour l’année suivante dans le cadre de la « capitale de la culture ». Il y a Demoiselle K (Benoît Gontier), jeune « écrivaine-performeuse », impertinente et branchée, originaire de Lille, et Agustín Altamirano (Juan Manuel Villalobos), romancier mexicain reconnu, plus âgé mais en plein doute. Un raté de l’organisation intervertit les courriers qui leur sont destinés et, à partir de là, ils s’écrivent sans pouvoir se rencontrer tout en étant hébergés dans des lieux de passage obligés par les organisateurs pour la rédaction d’une performance-texte, Le Corps de Marseille, pour Demoiselle K, et du Roman de Marseille pour Agustín Altamirano ; projets qui, bien sûr, ne verront jamais le jour. Ainsi Demoiselle K logera dans des lieux comme la maison natale du sculpteur César à la Belle de Mai, puis à l’emplacement de la Villa Air-Bel, qui accueillit Varian Fry, André Breton et nombre de surréalistes en 1940-1941. Elle rejoint ensuite le centre d’entraînement de l’OM et différents endroits du nord de la ville, notamment la Place François Maleterre, à l’Estaque, dans la maison où résida Cézanne qui y peignit les quartiers pauvres qui finissent sur les murs des riches – comme dit en substance la voix off à la fin de Marius et Jeannette -, puis finalement le centre-ville et le fort médiocre Mémorial de la Marseillaise d’une rue Thubaneau délaissée par les prostituées d’antan et les petits-bourgeois et touristes d’aujourd’hui… Altamirano, plus classiquement, habite un hôtel du Vieux-Port puis les rues du centre où résidèrent, durant leur jeunesse, des écrivains célèbres, tels Albert Cohen ou Marcel Pagnol, avant de visiter les vieilles ennemies de la ville : Aix-en-Provence et Paris. Le Mexicain fait aussi une brève excursion à Lourmarin sur la tombe d’Albert Camus, « l’un des meilleurs écrivains qu’ait donné votre pays » écrit-il fort justement. Il ne savait pas encore le fiasco que serait le centenaire de la naissance de l’auteur de L’Étranger du fait, entre autres, d’élu(e)s dont le qualificatif d’abruti(e)s et de poissonniers-ières serait une insulte indigne pour les faibles d’esprit – qui n’en peuvent mais… – et pour les honorables représentants de cette fort utile et respectable profession.
Chacun des protagonistes écrit dans son propre style, lequel évolue au fil de leurs relations, du convenue à l’intime, et, bien sûr, du support choisi. Demoiselle K. réalise ainsi des prodiges d’inventivité en l’absence de toute ponctuation, utilisant les outils numériques quand sa boulimie d’écriture ne peut, ou ne veut, se satisfaire de la feuille blanche. Maniant les clichés au second degré et ironisant avec à-propos sur les travers d’un événement convenu qui n’a de « culturel » que l’appellation, les deux auteurs dynamitent les travers de telles manifestations. Ils font aussi preuve, en particulier Demoiselle K., d’une rare connaissance de la ville mâtinée d’un humour ravageur. On appréciera aussi le changement de ton qui intervient vers la fin du livre avec le passage de la dérision à l’inquiétude, puis à la folie, tandis que les personnages se rencontrent enfin et délaissent la lettre pour le journal intime. Mêlant fiction et réalité, jonglant avec les genres narratifs, les auteurs illustrent bien le phénomène d’attraction-répulsion que suscite souvent Marseille pour ceux qui y viennent pour la première fois comme pour ceux qui la connaissent bien, tout en révélant les multiples aspects d’une ville qui, n’en déplaise aux esprits étroits, doit beaucoup à la littérature – et réciproquement. Ces quelques lignes sont loin d’épuiser la richesse d’un livre à découvrir pour quiconque s’intéresse de près ou de loin à la ville en même temps qu’aux nouvelles formes d’écriture et de fiction…
Si l’histoire est aussi présente dès qu’on parle de Marseille, ce n’est pas seulement un effet des incertitudes du présent et des inquiétudes pour l’avenir, mais aussi du fait que, comme l’écrit encore Richard Cobb, la ville, « à travers son histoire d’une immense richesse, s’était montrée capable d’exister et de prospérer en l’absence de Paris, sans Paris »[4]. Crime majeur, quand on sait que, depuis des siècles, « il n’est bon bec que de Paris » !
Il est justement question d’histoire avec Etrangers antifascistes à Marseille, et d’une histoire en construction qui dévoile des aspects méconnus ou ignorés d’une période pourtant rebattue. L’historien Robert Mencherini y propose les actes, richement illustrés, d’une journée du très inégal colloque international, « La culture de l’Europe en exil à Marseille (1940-1944) », sans conteste la plus intéressante de l’ensemble. Sur place, le public, nombreux ce jour-là, ne s’y était pas trompé. Précédés d’une longue introduction du maître d’œuvre de la journée sur le contexte des étrangers antifascistes « entre refuge, internement et résistance », ces actes proposent d’abord le témoignage de Mélanie Berger-Volle, née à Vienne, en Autriche, en 1921 dans un quartier ouvrier. Très jeune, elle rejoignit un groupe d’extrême gauche dirigé, entre autres, par Georg Scheuer[5]. Après l’Anschluss – l’annexion de l’Autriche par l’Allemagne nazie en mars 1938 -, elle dut quitter clandestinement son pays pour la Belgique, puis la France. Lors de la déclaration de guerre, elle fut arrêtée comme d’autres étrangères et devait être internée au camp de Gurs, mais parvint à s’échapper. Après juin 1940, elle erra dans le Sud de la France, puis rejoignit un groupe de camarades à Montauban où ils rédigeaient et diffusaient des tracts destinés aux soldats allemands. Arrêtée en janvier 1942 par la police, elle fut emprisonnée à Toulouse et condamnée à 15 ans de travaux forcés et 20 ans d’interdiction de séjour le 18 décembre 1942. Elle fut alors transférée à la prison des Baumettes à Marseille et, malade, hospitalisée à l’hôpital de la Conception dont elle s’évada avec une institutrice de La Ciotat, militante trotskiste, Marguerite Usclat, grâce à un groupe de camarades. Elle gagna ensuite Dijon, puis Lyon, et, enfin, Paris, tout en poursuivant ses actions de résistance jusqu’à la Libération. Naturalisée française en 1947, elle poursuit depuis un important travail de mémoire avec les associations d’anciens résistants, internés et déportés.
Ce beau témoignage est suivi d’une étude sur les Espagnols du Groupe de travailleurs étrangers de Meyreuil, d’une évocation de l’itinéraire du dirigeant communiste italien Giuliano Pajetta par sa fille Elvira et d’une étude de Gérard Malgat sur le diplomate Gilberto Bosques[6]. Ce dernier fut consul du Mexique à Paris à partir de janvier 1939 pour secourir l’exil espagnol au moment de la victoire de Franco. Arrivé à Marseille au début de l’été 1940, il y poursuit son action jusqu’en novembre 1942, délivrant nombre de visas et quantité de secours pour les persécutés, ouvrant deux résidences pour les réfugiés espagnols dans le quartier de Saint-Menet. Avec sa famille et l’ensemble du personnel diplomatique mexicain, ils sont alors assignés à résidence, puis transférés en Allemagne fin janvier 1943. Ils rentreront au Mexique fin mars 1944 après un échange de prisonniers entre l’Allemagne et le Mexique.
Complétés des nécessaires « aperçus bibliographiques » sur le sujet, ces actes apportent d’utiles éclairages sur des aspects ignorés de la période, démontrant l’apport des « étrangers » à la Résistance et ses aspects internationalistes, en particulier avec le témoignage de Mélanie Berger-Volle, tout en rendant un juste hommage à l’action, jusqu’alors ignorée ou négligée, du consul mexicain Gilberto Bosques.
Terminons enfin, last but not least, avec le Marseille de Germaine Krull, réédition à l’identique d’un ouvrage paru en 1935. Née en 1897 de parents allemands dans une région rattachée à la Pologne en 1921, après le traité de Versailles, Germaine Krull étudie la photographie à Munich et ouvre un atelier tout en fréquentant les mouvements d’avant-garde et les milieux révolutionnaires. Arrêtée après la Commune de Munich, elle est expulsée de Bavière et se rend à Berlin où elle rencontre le jeune cinéaste hollandais Joris Ivens qu’elle suit à Amsterdam en 1925 où elle est séduite par la beauté des constructions métalliques du port. Installée à Paris l’année suivante, elle initie à la photographie un jeune roumain, Eli Lotar, avec qui elle vit durant trois ans. A la suite de ses photographies industrielles, elle publie Métal qui marque l’histoire de la photographie et réalise ses premiers clichés de la Tour Eiffel qui paraissent dans Vu, inaugurant une longue collaboration et d’innombrables reportages pour le magazine de Lucien Vogel. Elle collabore aussi à Marianne ou à des publications d’avant-garde comme Bifur. En 1931, Pierre Mac Orlan écrit à son propos dans le premier volume de la collection « Les photographes nouveaux », chez Gallimard, qui lui est consacrée : « elle ne crée pas des anecdotes faciles, mais elle met en évidence le détail secret que les gens n’aperçoivent pas toujours, et que la lumière de son objectif découvre là où il se cachait ». En 1937, elle s’installe à Monaco et réalise des reportages mondains. Partie au Brésil après l’armistice de juin 1940, elle rejoint Brazzaville et dirige le service photographique de la France libre. Elle suit la campagne de l’armée française du général de Lattre de Tassigny. En 1946, elle devient correspondante de guerre en Asie, travaillant pour une agence photo de Bangkok. Ensuite, elle y restaure et dirige un célèbre hôtel international. A l’âge de soixante-dix ans, elle rejoint une communauté tibétaine en Inde, avant de revenir en Europe en 1983 où elle meurt, à Wetzlar, en RFA, deux ans plus tard. Voilà pour l’auteur de ces photos au parcours atypique et aventureux. Pour les photos elles-mêmes réalisées au début des années 1930, elles illustrent parfaitement l’activité foisonnante d’un port de dimension mondiale qui était encore dans la ville : navires serrés, quais débordant d’activités, grues entre reflets de la mer et ciel nuageux, cheminées d’usines et entrepôts, amoncellements de sacs, de tonneaux, de marchandises déchargées à dos d’homme par les dockers… Et puis le Pont Transbordeur, magnifique monument de métal, dont elle a réalisé, avec le hongrois Moholy-Nagy, quelques-uns des plus beaux clichés. Les « vieux-quartiers » aussi, autour du Vieux-Port, détruits par les nazis en 1943, et dont les habitants semblent illustrer la remarque de Suarès : « un bon peuple sans fiel et qui aime sa bonté ». Bref, il faut avant tout inviter le lecteur à aller voir de près ces photographies en gardant à l’esprit ce que disait elle-même Germaine Krull de son travail : « La première science du photographe est de savoir regarder… Le même monde vu par des yeux différents, ce n’est plus tout à fait le même monde, c’est le monde à travers la personnalité… Chaque angle de vue nouveau multiplie le monde. »
Ne laissons donc pas passer l’occasion de multiplier notre regard sur les restes d’une ville où des édiles, au mieux imbéciles et incultes, laissent tomber en ruines les derniers restes d’un passé prestigieux[7] et saluons le travail de ceux qui, ici même, écrivent au quotidien une longue histoire loin du bon ton parisien.
Marius Escartefigue
Les livres conseillés
Juan Manuel Villalobos, Benoît Gontier, If Marseille…, L’atinoir, 2013, 276 p., 15 € ; Robert Mencherini (dir.), Étrangers antifascistes à Marseille 1940-1944, Éditions Gaussen, 2014, 152 p., 25 € ; Marseille par Germaine Krull (texte d’André Suarès), Éditions Jeanne Laffitte, 2014, 64 p., 29 €.
[1] Par exemple :
L’étude est consultable ici :
[2] Richard Cobb, Marseille, Allia, 2001, p. 11.
[3] Lire Jérémy Beschon, Baraque de foire, L’atinoir, 2013 :
[4] Richard Cobb, op. cit., p. 11. On en jugera en lisant l’indispensable Histoire universelle de Marseille d’Alessi dell’Umbria (Agone, 2006).
[5] Lire les mémoires de Georg Scheuer, Seuls les fous n’ont pas peur. Scènes de la guerre de Trente ans (1915-1945), Syllepse, 2002. Ce groupe, les Revolutionäre Kommunisten Deutschlands (Communistes révolutionnaires d’Allemagne), était issu du trotskisme mais considérait l’URSS comme une société capitaliste et s’opposait à sa défense inconditionnelle. Dès la fin de 1940, il entreprend des activités de résistance dans le sud de la France sur la base du « défaitisme révolutionnaire » et publie à partir de janvier 1943 Fraternisation prolétarienne qui invite les soldats allemands à déserter et à se révolter.
[6] Pour de plus amples informations, lire Gérard Malgat, Gilberto Bosques ou la diplomatie au service de la liberté. Paris-Marseille (1939-1942), L’atinoir, 2013.